The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.
DANS LE SILLAGE DE BERGSON : LA PHRASE DE LA VIE
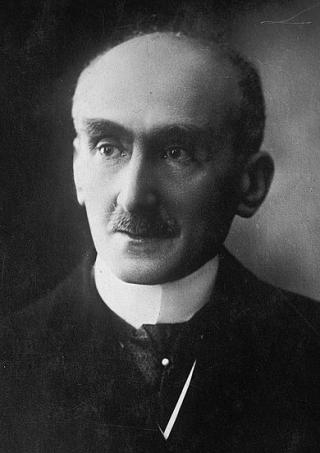
Dans son souci de restituer à la vie toute sa plénitude contre son traitement schématique par l'intelligence, Bergson plaide pour le devenir, volontiers dynamique, contre l'être, foncièrement statique. Aussi restaure-t-il le temps dans toute sa concrétude. Ce n'est plus une suite discontinue et infinie d'instants comme dans la physique mais la durée telle qu’elle est vécue par l’individu sur le mode d'une évolution comportant des phases de maturation et de vieillissement. On ne saurait postuler de métaphysique qui n’aurait pas de lien avec les contingences et les vécus humains dont la trame des trames reste la durée qui donne ses latitudes à la vie. Ainsi entendue, la métaphysique présente l'insigne mérite de réhabiliter le sens commun contre les abstractions atemporelles comme les Idées, les Essences ou les Concepts. Voire, elle ne serait pertinente qu'autant qu'elle s’illustre et s'éprouve comme psychologie. Les questions philosophiques ne se poseraient plus en termes d'espace – à l'instar des questions portant sur la distinction entre le sujet et l'objet de la connaissance – mais en termes de temps qui constitue, pour reprendre cette fois Bergson, « l'étoffe de la vie psychologique ».
Bergson en vient à récuser toute conception substantielle – statique – de l'identité pour une conception mouvante, investie par le passé et ouverte à l'avenir. L'identité est vécue sur le mode d'une histoire en élaboration constante dont l’action reste inachevée : « Que sommes-nous en effet, qu'est-ce que notre caractère, sinon la condensation de l'histoire que nous avons vécue depuis notre enfance, avant notre naissance même, puisque nous apportons avec nous des dispositions parentales » (H. Bergson, L'Evolution créatrice, Quadrige PUF, 1983, p. 5). La personnalité serait cumulative, se bâtissant des expériences passées qui instruisent, à chaque instant, nos choix et nos actions sans les déterminer pour autant : « On a donc raison de dire que ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes ; mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons, et que nous nous créons continuellement nous-mêmes » (H. Bergson, Matière et Mémoire, PUF-Quadrige, 1985, p. 167-68).
Cette conception privilégie le rôle de la mémoire qui s'impose comme le synthétiseur des souvenirs qui instruit le vécu et aiguille son histoire. C'est elle qui déploie la perspective du passé sur le présent, le remodelant sans cesse, selon l'individu et son âge : l'expérience acquise instruit l'expérience présente pour finir, avec la vieillesse, par la submerger. Le poids du passé que la mémoire exerce sur l'action nuance la liberté de l'individu dont les choix se ressentent des expériences passées et des souvenirs qu’elles ont laissés. La liberté mobilise les souvenirs et s’en dégage plutôt qu’elle les rature et s’en secoue : « On pourrait dire que nous n'avons pas de prise sur l'avenir sans une perspective égale et correspondante sur le passé, que la poussée de notre activité en avant fait derrière elle un vide où les souvenirs se précipitent, et que la mémoire est ainsi la répercussion, dans la sphère de la connaissance, de l'indétermination de notre volonté » (H. Bergson, Matière et Mémoire, p. 67). En fait, Bergson distingue entre deux mémoires : celle de l’organisme, coulée en lui comme habitudes (ou habitus), « ensemble des mécanismes intelligemment montés qui assurent une réplique convenable aux diverses interpellations possibles » ; l’autre, retenant, datant et ordonnançant les vécus, « coextensive à la conscience ».
La réhabilitation de la mémoire comme réservoir (davantage que comme source) du sens conteste les prétentions de l'idéalisme à structurer la connaissance selon les seules lois d'une raison désincarnée et désengagée du monde. Elle recouvre une réhabilitation des souvenirs et des préjugés, écartés par le leurre d’objectivité, qui se glissent à notre insu ou avec notre consentement dans l’interprétation de nos vécus : « En fait », écrit Jankélévitch, « il n'est de perception qu'interprétée car mon passé suit mon action comme une ombre, et c'est bien ce qui empêche les subjectivistes d'admettre une perception "pure" » (V. Jankélévitch, Bergson, p. 145-46). La mémoire est active tant au niveau de la perception, synthèse des sensations et des souvenirs, que de l'action, portée par la synthèse des sollicitations et des souvenirs. La connaissance se déploie comme anamnèse : « Percevoir finit par n'être qu'une occasion de se souvenir » (H. Bergson, Matière et Mémoire, p. 68). Que les préjugés cultivent l'illusion plutôt que la vérité n’est pas pour intimider un auteur plaidant pour la vitalité de la vie contre l'anémie de l'intelligence. Toute connaissance étant nourrie par des préjugés, elle se révèle riche en illusions, plus vitales – mobilisatrices d'énergie créatrice – que les vérités – inhibitrices – de l'intelligence. Jankélévitch tire les conséquences des thèses de son maître :
« L'illusion est le pain quotidien de l'expérience ; elle supplée aux lacunes du donné ; elle parle encore quand l'illusion s'est tue depuis longtemps ; elle travaille là où la réalité cesse de fournir ; la perception mixte n'est elle-même que le commerce perpétuel de nos illusions, à l'illusion elle doit son âme, comme elle doit son corps aux choses véritables. L'illusion n'est donc pas seulement l'évasion de ceux que le présent vient trahir, elle met le perçu en notre possession plénière, elle nous place dans un avenir de familiarité où rien n'est muet à notre expérience, indifférent à notre mémoire. La connaissance devient reconnaissance ; un réseau de subtiles et merveilleuses sympathies attache l'esprit au réel » (V. Jankélévitch, Bergson, p. 146-47).
Le récit de la vie se présente à chaque moment comme la synthèse inachevée des souvenirs conservés dans la mémoire où ils investissent les sensations pour en faire des perceptions. Bergson recourt à des métaphores quasi littéraires pour restituer la continuité imprévisible et inachevée du psychisme : « Je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dans le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée de points. Et je crois par conséquent aussi que notre passé tout entier est là, subconscient – je veux dire présent à nous de telle manière que notre conscience, pour en avoir la révélation, n'ait pas besoin de sortir d'elle-même ni de rien s'adjoindre d'étranger : elle n'a, pour percevoir distinctement tout ce qu'elle renferme ou plutôt tout ce qu'elle est, qu'à écarter un obstacle, à soulever un voile » (H. Bergson, L'Energie spirituelle, PUF-Quadrige, 1982, p. 57). Dans son parcours de vie, l'individu ne cesse de choisir sa voie, écartant toutes les autres ; d’assumer un personnage, négligeant tous les autres ; d’exercer sa liberté, éliminant des possibilités de vie qu’il ne retrouvera plus : « La route que nous parcourons dans le temps et comme temps est jonchée de débris de tout ce que nous commençons d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir » (H. Bergson, L'Evolution créatrice, p. 101).
L'individu se retrouve constamment à une croisée des chemins, confronté à des choix, qu'il prend ou qu'on prend pour lui, dans le contexte d'une vision – d’une toile – générale du monde et de l'homme, où se mêlent considérations logiques, morales, religieuses, sociales. Dans son développement, il ne cesse de rétablir les synthèses sur le fond desquelles il évolue et que de nouvelles conditions génétiques et/ou contextuelles viendront déranger et remanier. À chaque instant, le moi entretient avec soi une relation qui prend ses instructions à un récit : nous serions (le personnage d') un récit meublé de souvenirs, dans la composition duquel entrent le travail de l'intelligence et celui de l'imagination, inextricablement mêlés l'un à l'autre, au point que toute tentative de les séparer, distinguant le génétique du social, le logique du passionnel, etc., se solde par un échec. On peut certes esquisser une histoire générique, qu'elle se veuille universelle ou particulière, à l'instar des diverses théories du développement, fondées sur des stades génétiques et sexuels (Sigmund Freud), génétiques et logiques (Paul Piaget), génétiques et moraux (Laurence Kohlberg), sociaux et génétiques (Erik E. Erikson), etc. Mais toute histoire de ce genre ne proposerait qu'un squelette du psychisme, sans toutes les passions de la chair et tous les raisonnements de l'esprit qui donnent ensemble sa singularité à l'individu.

