The Euro-Mediterranean Institute for Inter-Civilization Dialog (EMID) proposes to promote cultural and religious dialogue between Mediterranean civilisations ; to establish a network of specialists in inter-Mediterranean dialogue ; to encourage Euro-Mediterranean creativity ; to encourage exchange between Mediterranean societies ; to work to achieve Mediterranean conviviality ; to advise charitable organisations working around the Mediterranean and provide the support necessary to achieve their original projects.
NOTES PHILOSOPHIQUES : LE MENAGE DE LA PHILOSOPHIE
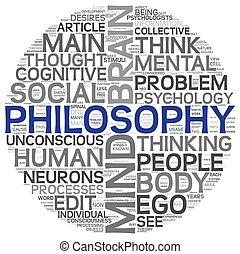
Qu’est-ce que la philosophie ? – On le saurait de moins en moins. – Sur quoi porte-t-elle ? – Soit sur l’homme, soit sur la nature, soit sur elle-même et le plus souvent sur les trois ensemble dans un embrouillamini qui confond la pensée. Dans le premier cas, l’étude serait proche, quoiqu’irréductible, à ce que l’on nommait les sciences de l’esprit ; dans le second, des sciences de la nature ; dans le troisième cas, du verbiage scolastique. La principale category mistake, source de toutes les autres, consisterait à traiter l’esprit en termes naturels ou la nature en termes spirituels. – Pourtant certains phénomènes tombent sous les deux registres comme le langage qu’on traite en termes anthropologiques ou/et naturels. Dans le premier cas, on se perd en considérations somme toute aléatoires, dans le second en considérations logico-linguistiques consistant à établir des passerelles entre les deux registres et à les soumettre à la critique de sommités dans les deux registres.
Maintenant que les sciences ont pris le relais de la philosophie dans la recherche et la découverte, celle-ci bredouille en quête d’une vocation. Ses traités, si tant est qu’on en produise encore, ne rivaliseraient jamais avec ceux des sciences naturelles, y compris les logiques mathématiques (ou les mathématiques logiques), ni avec les études littéraires (sciences humaines et sociales). Elle réclame assurément l’étude des textes classiques, mais elle ne saurait se borner à leur compilation et à leur interprétation, à moins qu’elle ne se résolve à participer de la geste scolastique qui naît dans le sillage de toute école philosophique généralement centrée sur l’étude d’un corpus de textes. Elle ne saurait voir dans l’essai, de plus en plus loqueteux, une contribution digne de la poursuite de la vérité. Elle ne saurait davantage trouver sa vocation dans la vulgarisation des sciences qui ne réussit pas à combler les écarts entre les formules mathématiques et les discours humains (c’est toute une topologie de la pensée qui se développe dans les parages des mathématiques). Un siècle plus tard on n’a toujours pas de philosophie quantique et l’on en reste à des tentatives vouées à l’échec d’expliciter le quantisme en des termes philosophiques tributaires de la science euclidienne-newtonienne. Ce n’est pas un hasard si depuis que les sciences poussent la philosophie dans ses retranchements, celle-ci se borne à s’attacher à la logique-mathématique ou verse, plus pathétique, dans la théosophie.
La bibliothèque des textes classiques est si vaste qu’une vie passée en lectures ne suffirait pas par ailleurs à la couvrir. Leur étude, même partielle, suffit-elle pour autant à faire de leur lecteur assidu un philosophe ? – Encore doit-il prendre le risque de distinguer dans le fatras des thèses et de leurs commentaires ce qui est essentiel/pertinent/prégnant de ce qui ne l’est pas. – Comment distinguer ? – En exerçant son jugement. – C’est-à-dire ? – Récuser en doute l’écrit comme du baratin destiné à convaincre le lecteur ou le discours destiné à séduire l’auditeur. Tout jugement requiert l’exercice du doute et le recouvre. – Descartes proposait l’idée d’infini pour poser les certitudes requises pour reconstruire ce que le doute déconstruit. Son infini recouvrait un Dieu qui ne saurait abuser. Or l’on sait qu’il n’est rien de plus abuseur que Dieu surtout lorsqu’il s’affuble de textes, que guette le dogme, et qu’il se coule dans des rites, que guette le schéma. Le philosophe ne s’accroche pas à Dieu sinon dans sa vie charnelle et pour les besoins du rite qui compose ce qui lui tient lieu de liturgie de vie.– Que pouvons-nous invoquer d’autre que l’infini-Dieu ? – La certitude du doute ou le doute de la certitude. Le philosophe ne se départ pas de son doute ; il lui demande débroussailler, d’éclaircir, de distinguer. Ce n’est pas à lui à reconstruire mais au savant, au poète, au prédicateur, au politique.
Wittgenstein assignait à la philosophie une tâche ménagère consistant, par-delà l’étude de l’usage du langage, de faire le ménage dans la logorrhée littéraire qui se déverse dans des quantités de plus en plus brouillonnes et proposer des distinctions qui permettraient de mieux débarrasser le discours des scories qui l’encombrent, des nœuds qui le nouent, des illusions qui s’insinuent dans un usage inconsidéré du langage. "What is your méthod in philosophy ? To show the fly the way out the bottle" (Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, § 309).

